
La détérioration des relations entre les deux pays depuis 2020 a conduit à une dangereuse escalade des tensions frontalières
La région frontalière entre le Mali et la Mauritanie est devenue l'une des régions les plus turbulentes du continent africain. L'impact croissant du terrorisme dans la région du Sahel et, plus particulièrement, à la frontière entre ces deux pays, a poussé les forces militaires maliennes à dépasser les limites de leurs opérations et à pénétrer sur le territoire mauritanien, ce qui a suscité l'indignation du gouvernement mauritanien.
Le nid de frelons du Sahel
Pour comprendre le conflit entre le Mali et la Mauritanie, il faut remonter à l'histoire de l'instabilité de la région nord-africaine du Sahel, une bande de terre bordée au nord par le désert du Sahara et au sud par la savane soudanaise. Elle s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, traversant le territoire de dix pays : le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie.
Comme l'explique un rapport du département de la sécurité nationale du gouvernement espagnol, depuis le début des années 1990, le terrorisme djihadiste a trouvé dans le nord du Mali et le reste du Sahel le scénario idéal pour exploiter la faiblesse institutionnelle des gouvernements nationaux, en comblant le vide étatique et en usurpant leurs compétences.
La situation s'est aggravée depuis 2008, avec l'implantation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dans la région. Cette organisation terroriste a annoncé la création d'un émirat islamique dans le nord du Mali, bien que l'intervention militaire de la France ait empêché les djihadistes de renverser le régime de Bamako.
Néanmoins, le terrorisme a continué à se développer au Sahel. À la présence d'AQMI s'est ajoutée celle de l'État islamique, avec deux branches actives dans la région : Boko Haram, depuis 2015, à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ; et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord du Nigeria et le bassin du lac Tchad.
Les données compilées par l'Institut royal Elcano sont choquantes : en 2008, la région ne représentait que 1 % des décès dus au terrorisme dans le monde ; en 2024, ce chiffre atteindra 48 %. Cinq des dix pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent au Sahel, et sept des dix attentats les plus meurtriers y ont été perpétrés.
L'échec du G5S
Pour lutter contre ce fléau, cinq pays de la région (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont créé le G5 Sahel, ou G5S, lors d'un sommet des chefs d'État qui s'est tenu en février 2014 à Nouakchott, la capitale mauritanienne.
Son objectif était de créer un cadre de coordination pour les réponses régionales aux flux migratoires, à la radicalisation, à l'extrémisme violent et à la criminalité transnationale organisée.
Cependant, il n'a eu que peu d'impact. Les problèmes internes des pays membres du groupe ont précipité son échec : en mai 2022, le Mali a annoncé qu'il quittait le groupe pour protester contre le fait qu'il n'a pas été autorisé à assumer la présidence tournante en raison de sa situation politique interne.
En décembre 2023, le Niger et le Burkina Faso se sont également retirés du groupe, à la suite de coups d'État qui ont porté les militaires au pouvoir dans les deux pays - le coup de grâce pour le G5S.
Le conflit Mauritanie-Mali
Le conflit frontalier entre la Mauritanie et le Mali est actuellement l'un des points les plus chauds du Sahel. Le coup d'État qui a eu lieu au Mali en août 2020 et qui a précipité sa sortie du G5S a été le début de la détérioration des relations entre les deux pays voisins.
À partir de la fin de l'année 2021, la région occidentale du Mali, près de la frontière avec la Mauritanie, a commencé à subir une vague d'attaques terroristes, déclenchant la réaction des forces armées maliennes qui, en janvier 2022, ont traversé la frontière pour pénétrer dans la région d'Adil Bakrou, déclenchant des affrontements qui ont coûté la vie à sept civils mauritaniens. Le gouvernement a réagi en envoyant une délégation de haut niveau à Bamako pour discuter du contrôle et de la gestion de la frontière commune.
La crise d'avril 2024 a marqué un tournant dans les relations bilatérales entre la Mauritanie et le Mali, car elle a déclenché une escalade des conséquences : le gouvernement mauritanien a cessé d'autoriser les civils maliens à pénétrer sur son territoire sans autorisation préalable, perturbant ainsi le flux des éleveurs et des commerçants à travers la frontière.
À son tour, le sentiment d'hostilité croissant au Mali a conduit au blocage des camions mauritaniens entrant dans le pays à des fins commerciales, ce qui a provoqué de nouvelles protestations et des réunions entre les représentants des deux gouvernements.
Début mai, le porte-parole du gouvernement mauritanien a annoncé que les forces armées mauritaniennes étaient entièrement prêtes à défendre la patrie et a averti les deux parties de ne pas attaquer le territoire mauritanien. En guise de démonstration de force, le 4 mai, les forces armées mauritaniennes ont entamé des manœuvres militaires de grande envergure dans l'État du Hodh El Sharqi, impliquant l'armée de l'air et l'artillerie, en présence des ministres de la Défense et de l'Intérieur et du chef d'état-major de l'armée mauritanienne.
Autre démonstration : le 10 juin, la gendarmerie mauritanienne a organisé une manœuvre élargie impliquant plus de 1 500 hommes, avec plus de 200 véhicules militaires, dans la capitale Nouakchott, la ville côtière de Nouadhibou et les régions méridionales jusqu'à Kobni, près de la frontière malienne.
Proximité avec l'OTAN et la Chine
L'escalade des tensions avec le Mali et le rapprochement du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec la Russie ont contraint la Mauritanie à rechercher des appuis extérieurs, au premier rang desquels l'OTAN, soucieuse de contrôler les ingérences russes dans les pays du Sahel.
La Mauritanie a été invitée à participer au sommet de l'OTAN en juin 2022, qui a approuvé un paquet d'assistance à la sécurité et à la défense pour Nouakchott visant à améliorer sa capacité à faire face à de multiples menaces.
Pour l'OTAN, une relation plus étroite avec la Mauritanie est essentielle pour maintenir sa capacité à interagir avec les développements militaires et sécuritaires dans cette région troublée.
La Mauritanie s'est également tournée vers un autre acteur étranger de la région, la Chine, en faisant progresser ses relations diplomatiques, avec en point d'orgue la visite du président mauritanien à Pékin en juillet 2023.
Le gouvernement chinois a signé plusieurs accords avec la Mauritanie dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des énergies renouvelables, et a inclus la Mauritanie dans le programme d'allègement de la dette des pays africains.
Bien que cela n'ait pas été prouvé, il semblerait que les nouveaux drones utilisés par l'armée mauritanienne soient de fabrication chinoise, ce qui inclurait le secteur de la défense parmi les domaines de collaboration entre les deux pays.
Position stratégique
La Mauritanie est un cas particulier parmi les pays du Sahel en raison de sa position stratégique, qui est également un facteur déterminant de sa politique étrangère actuelle : géographiquement, elle fait partie des pays d'Afrique du nord, mais la concurrence entre deux géants économiques et militaires comme le Maroc et l'Algérie occulte son rôle dans la région. D'autre part, la Mauritanie constitue la frontière occidentale du Sahel, qui part du Soudan et passe par le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
La politique de la Mauritanie reflète le désir de tirer parti de cette position privilégiée en renforçant ses capacités globales pour devenir un troisième acteur en Afrique du Nord, ce qui attirerait les puissances internationalesintéressées par les perspectives prometteuses liées à l'exploration pétrolière et gazière et aux ports commerciaux.
Cela nécessitera également une stabilité politique. Les récentes élections présidentielles n'ont pas été en mesure de la garantir. Il s'agit là de la tâche inachevée de la Mauritanie pour renforcer son rôle dans la région.




.jpeg)








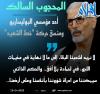




.jpeg)