
La Mauritanie s’apprête à tourner la page du monopole public sur la production électrique. Historiquement, la SOMELEC société publique verticalement intégrée détenait l’exclusivité de la production, du transport et de la distribution d’électricité sur le réseau principal, en vertu d’un contrat-programme reconduit après l’échec de sa privatisation en 2002. En pratique, aucun producteur indépendant (IPP) n’a pu opérer sur le réseau interconnecté national malgré l’ouverture théorique du marché depuis 2001. Cette situation va changer radicalement : dorénavant, l’État ne construira plus de centrales par ses propres moyens, laissant aux producteurs privés, via des partenariats public-privé (PPP), le soin d’investir dans de nouvelles capacités de génération. Le premier grand projet IPP est déjà en préparation une centrale à gaz de 225 MW utilisant le gaz offshore GTA et sera développé entièrement par un opérateur privé selon le nouveau cadre légal. Cette libéralisation met fin au monopole de fait de la SOMELEC sur la production et ouvre la voie à une concurrence encadrée dans l’achat d’électricité, y compris la possibilité pour certains grands consommateurs éligibles de contracter directement avec le producteur de leur choix. Pour les investisseurs et bailleurs, le message est clair : le secteur mauritanien de l’électricité est désormais ouvert à un rôle bien plus important du privé, avec l’État en retrait sur la génération.
Nouveau code de l’électricité et réformes réglementaires
Ce virage stratégique s’appuie sur une refonte profonde du cadre juridique et réglementaire. Un nouveau Code de l’électricité adopté en 2022 pose les bases d’un secteur moderne, intégrant la transition énergétique et les découvertes de gaz, consacrant la régulation indépendante et la promotion de l’électrification rurale. Ce Code prévoit une libéralisation progressive du marché et l’introduction de la concurrence, notamment via les IPP, tout en encadrant rigoureusement leurs activités par l’Autorité de Régulation (ARE). Parallèlement, la loi sur les partenariats public-privé (PPP) a fait l’objet de révisions majeures (en 2021 puis 2024) afin de faciliter le montage de projets IPP compétitifs et bancables. L’ensemble du dispositif est désormais opérationnel grâce à la parution des décrets d’application en 2024 et à des arrêtés sectoriels pris dans le cadre d’un programme de renforcement de capacités. Parmi les avancées notables, figure la mise en place prévue d’un guichet unique pour simplifier et accélérer l’obtention de toutes les autorisations nécessaires aux investisseurs privés, réduisant ainsi les coûts de transaction. De plus, le gouvernement s’est engagé à finaliser un Code du réseau électrique d’ici 2025, un référentiel technique crucial pour intégrer les nouvelles centrales et garantir l’accès non discriminatoire des tiers au réseau.
Un Pacte national de l’énergie aux objectifs 2030 ambitieux
Ce graphique met en lumière les fortes disparités entre zones urbaines (91 %) et rurales (6 %), avec une moyenne nationale de 55 %.
La Mauritanie a formulé sa vision dans un Pacte National de l’Énergie qui fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030, alignés sur les engagements internationaux du pays en matière d’accès universel et de transition verte. Parmi les cibles clés figurent :
1- Accès universel à l’électricité d’ici 2030.
Fournir l’électricité à 3,4 millions de personnes supplémentaires, faisant passer le taux d’accès national de 55 % actuellement à 100 %. Cet effort mettra l’accent sur les zones rurales, où le taux d’accès n’est encore que de 6 % contre 91 % en milieu urbain, afin de corriger de fortes disparités régionales.
2- Porter la part des énergies renouvelables à 70 % du mix électrique.
Le Pacte vise un basculement massif vers le solaire, l’éolien et l’hydraulique, tout en augmentant de 66 % la capacité de production nationale (multiplication par 1,66) . En 2023, grâce notamment aux barrages de l’OMVS, aux parcs éoliens et solaires nouvellement installés, environ 44 % de l’électricité produite sur le réseau provenait déjà de sources renouvelables (27 % hydro, 13 % éolien, 4 % solaire) un pourcentage appelé à croître fortement pour atteindre l’objectif de 70 %.
3- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur.
En remplaçant les centrales fuel/diesel par des énergies propres et en introduisant le gaz domestique comme combustible de transition, la Mauritanie entend diminuer l’intensité carbone de son électricité. Chaque nouveau projet renouvelable ou à gaz s’accompagne d’estimations de CO₂ évitées par exemple, la future centrale solaire de 50 MW à Kiffa permettra d’économiser environ 70 500 tonnes de CO₂ par an. Cet effort s’inscrit dans la contribution climat du pays tout en améliorant la qualité de l’air local.
4- Exploiter le gaz naturel national pour l’électricité.
Le Pacte mise sur une montée en puissance du gaz domestique dès la mise en production du champ offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Une centrale à cycle combiné de 225 MW alimentée par le gaz de GTA est planifiée en IPP. En parallèle, le développement du gisement gazier de Banda (onshore) est en discussion, et les énormes réserves du champ de Birallah (jusqu’à 80 TCF) laissent envisager la Mauritanie comme futur hub énergétique régional à moyen terme. L’intégration du gaz local dans le mix permettra de sécuriser l’approvisionnement tout en réduisant la dépendance aux coûteux hydrocarbures importés.
Un plan d’investissement de 3 milliards USD adossé au privé
Atteindre ces objectifs nécessite des investissements massifs estimés à 3,067 milliards USD, dont 2,446 milliards restent à mobiliser. Le plan prévoit une contribution substantielle du secteur privé de 1,23 milliard USD, soit environ 50 % du total via les IPP et autres initiatives entrepreneuriales. Le reste proviendra des fonds publics et des bailleurs de fonds internationaux. Par segments, la répartition financière se décline comme suit :
Production (génération) : estimait à 1 463 M$ au total, dont l’essentiel et1 171 M$ attendu des investisseurs privés (soit 80 % du coût des nouvelles centrales). Ce volet inclut les fermes solaires et éoliennes à venir, ainsi que la centrale à gaz 225 MW, qui seront majoritairement développées en IPP.
Transport (réseau haute tension) : 375 M$, financés intégralement par des ressources publiques ou concessionnelles, pour renforcer et étendre le réseau de transport national et transfrontalier. Des projets structurants comme les lignes 225 kV vers le Sénégal et le Mali en font partie.
Distribution (réseaux MT/BT) : 189 M$, également couverts par des financements publics et partenaires techniques . Ce montant s’ajoute à plusieurs projets en cours (financés par la Banque mondiale, le Fonds koweïtien, l’Espagne, la JICA, etc.) visant l’extension du réseau de distribution urbaine et rurale.
Énergies renouvelables décentralisées (ERD) : 155 M$ pour les solutions hors-réseau (mini-réseaux solaires, systèmes domestiques, etc.), dont une part privée estimée à 51 M$ (en particulier via des opérateurs locaux pour la gestion de mini-grids) . Ce segment est crucial pour électrifier les localités isolées non raccordables au réseau national.
Cuisson propre : 205 M$ dédiés à la diffusion de solutions de cuisson propres (foyers améliorés, GPL, biogaz…), financés principalement par les pouvoirs publics et bailleurs . L’objectif est de tripler le taux d’accès à des modes de cuisson non polluants, qui stagne autour de 4 % par an actuellement, afin d’atteindre plus de la moitié des ménages d’ici 2030.
Ce plan d’investissement ambitieux a été détaillé dans le Pacte national de l’énergie, avec un calendrier d’exécution échelonné entre 2024 et 2030 . Le Gouvernement mauritanien en appelle à la communauté des bailleurs et au secteur privé pour combler le gap de financement restant . La moitié environ des ressources étant espérée du privé, la réussite de ce plan dépendra largement de la confiance des investisseurs et de la capacité du pays à structurer des projets rentables.
Faisabilité des objectifs 2030 ?
Fournir l’électricité à 3,4 millions de personnes supplémentaires, porter la part des énergies renouvelables à 70 % du mix, mobiliser 1,23 milliard de dollars d’investissements privés et réduire significativement les émissions du secteur sont autant de cibles ambitieuses, mais qui supposent une mise en œuvre accélérée et sans faille. Or, au regard des défis techniques, financiers et institutionnels encore présents -faiblesse du rendement du réseau, lourde dépendance aux financements extérieurs, bancabilité fragile des projets IPP, lenteur administrative- peut-on raisonnablement espérer atteindre ces objectifs dans les délais annoncés ?
Projets phares et intégration régionale
Plusieurs projets structurants sont déjà en cours pour concrétiser la transition énergétique mauritanienne. D’une part, le Schéma Directeur de Production et de Transport 2040, élaboré par Artelia (2023), sert de feuille de route technique pour orienter ces investissements prioritaires. Sur cette base, la Mauritanie déploie de nouvelles infrastructures :
• Projet BEST (Battery Energy Storage Technologies) : Dans le cadre du programme régional BEST, financé par la Banque mondiale, la Mauritanie bénéficie d’un appui de 90 millions de dollars pour améliorer l’accès et la fiabilité de l’électricité. Ce financement cible cinq régions: Trarza, Brakna, Gorgol, Assaba et Guidimakha et permettra l’intégration de systèmes de stockage d’énergie (batteries), essentiels pour stabiliser l’approvisionnement en milieu rural et exploiter au mieux les productions intermittentes issues du solaire.
• Intégration au marché ouest-africain de l’électricité (WAPP) : La Mauritanie est en voie d’intégration au West African Power Pool (WAPP), piloté par la CEDEAO, qui vise à créer un marché unifié de l’électricité en Afrique de l’Ouest. Déjà membre de l’OMVS aux côtés du Mali et du Sénégal, elle participe désormais aux mécanismes du WAPP en tant qu’observateur. Cette dynamique devrait être renforcée par des projets comme le PIEMM et l’interconnexion envisagée avec le Maroc, et permettra une meilleure fluidité des échanges transfrontaliers, une optimisation des infrastructures régionales, et une sécurisation collective de l’approvisionnement.
• Renforcement du réseau interconnecté et exportations : La mise en service de la ligne 225 kV Nouakchott–Saint-Louis vers le Sénégal est imminente, offrant une capacité d’export pouvant atteindre 60 MW. En parallèle, le grand Projet d’Interconnexion Électrique Mauritanie-Mali (PIEMM), financé par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l’AFD et JICA, est en cours. Il comprend la construction d’une ligne 225 kV vers le Mali ainsi que deux centrales solaires de 50 MW à Kiffa et Néma. La centrale de Kiffa (50 MWc avec stockage) est financée sur fonds publics internationaux, tandis que celle de Néma (50 MWc) sera réalisée en IPP privé. Ces infrastructures, achevées d’ici 2025-2026, permettront d’alimenter les régions enclavées du sud-est tout en ouvrant la voie à des exportations vers le réseau malien.
• Initiative Desert-to-Power : La Mauritanie est partie prenante de ce programme panafricain piloté par la BAD visant à déployer 10 GW solaires au Sahel. Une feuille de route Desert-to-Power nationale a été adoptée en 2022. Elle prévoit l’installation de fermes solaires de grande capacité dans le nord et l’ouest du pays, intégrées au réseau via des systèmes de stockage (batteries BESS) et des lignes de raccordement dédiées. L’objectif est de valoriser l’ensoleillement exceptionnel du Sahara mauritanien pour fournir une électricité compétitive, tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation vers les pays voisins.
• Mini-réseaux ruraux (RIMDIR) : Ce projet, premier PPP du secteur électrique mauritanien, vise l’électrification de 120 localités rurales par des mini-grids solaires. Financé par l’AFD, l’UE, la Banque mondiale et la BAD, RIMDIR met en place des centrales solaires de petite taille avec distribution locale, confiées en affermage à des opérateurs privés. Il permettra d’apporter l’électricité à des communautés isolées tout en expérimentant un modèle de délégation au privé sur le segment de l’électrification rurale, complémentaire à l’extension du réseau.
• Nouvelles centrales éoliennes et solaires IPP : Dans la région de Nouakchott, un projet solaire/éolien de 60 MW est en négociation via la Direction Générale des PPP. À Nouadhibou, une ferme éolienne de 100 MW, entrée en service en 2023, renforce déjà le mix renouvelable . D’autres initiatives privées sont envisagées, y compris des parcs solaires de 25 MW destinés aux villes minières comme Zouerate. L’intégration de ces nouvelles capacités vertes sera facilitée par la finalisation du Code du réseau en 2025, assurant des règles techniques claires pour raccorder et exploiter les installations intermittentes .
Sur le plan régional, la Mauritanie mise sur l’intégration au marché ouest-africain de l’électricité. Membre de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) aux côtés du Mali et du Sénégal, elle bénéficie déjà de l’énergie hydraulique des barrages de Manantali, Felou et Gouina (dont 27 % de l’électricité nationale en 2023). Désormais, Nouakchott entend accroître les échanges transfrontaliers : elle participe activement aux initiatives du Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA/WAPP) où elle a statut d’observateur. L’harmonisation des codes réseau et des tarifs de transit au niveau régional devrait faciliter à terme l’écoulement des surplus mauritaniens vers les pays voisins et l’importation en cas de déficit. Grâce à ses ressources abondantes (gaz, solaire, éolien) et aux interconnexions en développement, la Mauritanie se positionne progressivement comme un acteur clé du marché électrique régional, capable à la fois de satisfaire la demande domestique et d’exporter de l’énergie verte compétitive.
Emergence




.jpeg)









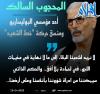



.jpeg)