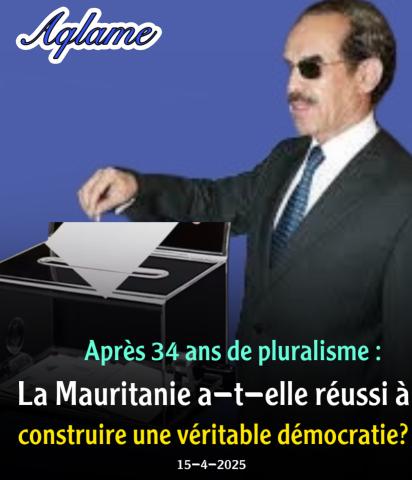
Au milieu d'avril de chaque année, la mémoire nationale évoque un moment clé dans l'histoire politique moderne de la Mauritanie : l'annonce du début du processus démocratique en 1991, accompagné de grandes espérances, de défis difficiles et de transformations dramatiques qui ont continué à interagir pendant plus de trois décennies. Ce tournant n'était pas seulement le résultat d'une conviction interne solide sur la nécessité d'une rupture avec le régime unilatéral, mais a également été le fruit d'une interaction pressante entre les crises structurelles du smystème en place, les manifestations sociales et politiques croissantes, et les changements régionaux et internationaux qui ont contraint de nombreux régimes à s'adapter au climat post-guerre froide.
Bien que l'annonce de la pluralité et de la nouvelle constitution ait marqué un lancement symbolique d'un processus démocratique longtemps attendu, la réalité qui se dévoile à la lecture du parcours post-avril 1991 est que la démocratie n'a pas été octroyée mais arrachée, et qu'elle n'a pas été réalisée d'un seul coup, mais ressemblait plutôt à un long travail de mise au monde, ponctué de moments d'escalade et de détente, d'échecs politiques, de succès électoraux, de coups d'État, d'accords internes et de luttes amères pour le pouvoir et la légitimité.
Dans cet article, nous cherchons à nous arrêter sur certains moments décisifs de ce parcours, en revenant à l'instant fondateur, en lisant le contexte national, régional et international qui a poussé le système à adopter l'option de l'ouverture, et en passant en revue ce que le mois d'avril – en particulier – a connu de transformations clés dans le parcours démocratique mauritanien. Nous essaierons, à travers ce retour historique et analytique, de réfléchir à l'expérience démocratique avec toutes ses contradictions, et d'ouvrir une fenêtre de débat sur une question de longue date : avons-nous réellement réussi à bâtir une démocratie? Ou vivons-nous encore dans un cercle fermé de succession au pouvoir, sans son essence?
L'accouchement de la démocratie mauritanienne
Le parcours démocratique, depuis son lancement en 1991, n’a laissé aucun mois de l’année - et peut-être aucun jour - passer sans qu’il soit marqué par un événement significatif.
Si le mois d’août s’est distingué par des coups d’État réussis et un réel dépassement des institutions démocratiques, le mois d’avril a réussi à donner sa propre empreinte aux événements d’importance exceptionnelle dans le processus de transition démocratique qu’a connue la Mauritanie.
Le 18 avril 1992 a vu l’inauguration du premier président mauritanien élu lors d’élections multipartites, et le 19 avril 2007, les Mauritaniens ont suivi - sous un intérêt régional et international - les cérémonies du premier transfert pacifique de pouvoir connu par notre pays, où le pouvoir a été remis au président démocratiquement élu, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Cependant, le 15 avril 1991 reste la date la plus symbolique, considérée comme le jour de la naissance du parcours démocratique mauritanien.
Les observateurs de ce parcours peuvent diverger dans l’évaluation de ses différentes étapes, mais la plupart d’entre eux y voient une expérience riche qui a mis le pays sur la bonne voie. Il a subi de nombreux secousses violentes, a évolué sous la pression de volontés puissantes cherchant à l’étouffer et à l’orienter à leur avantage, mais il est resté tel un phoenix, capable de se relever de ses cendres et de s’envoler à nouveau pour rappeler à ceux qui sont élus par le peuple, ou qui s’imposent à lui, que l’ère de l’individualisme au pouvoir et du contrôle du destin du peuple est révolue.
Les conditions de la naissance étaient difficiles et son atmosphère était chargée d’un ciel lourd de difficultés, mais le président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya a su trancher, annonçant au peuple mauritanien - à travers ce qui sera plus tard connu comme le discours de l’Aïd el-Fitr - d’un ton confiant qu’un référendum sera organisé la même année pour ratifier la Constitution et que des élections libres - entre autres - seraient organisées prochainement pour élire une Chambre des députés et un Sénat.
À l’époque, peu de gens réalisaient que derrière le ton confiant d’Ould Taya se cachait un profond sentiment de peur de couler au milieu d’un océan chargé de tensions et de perspectives bouchées. Le système s’efforçait alors de faire de la proclamation du 11 février 1991 un programme politique, économique et social, exploitant la campagne de réinstallation des structures de masse pour obtenir le soutien populaire. Cependant, les défis de l’époque étaient bien trop grands pour être affrontés avec des armes fragiles qui avaient déjà épuisé toute leur efficacité.
Cinq jours avant la date de la lettre, soit le 10 avril, le noyau dur du Front Démocratique Unifié des Forces de Changement (FDUC) avait tranché et décidé de sortir au grand jour "pour faire face aux dérives dangereuses du régime, voire pour mettre fin à une dictature qui prouve jour après jour son danger pour l'unité et la stabilité du pays".
Le 5 avril, l'Union des Travailleurs Mauritaniens avait ouvert la saison de mouvement de protestation et de revendication en déclenchant sa bombe sous la forme de trois lettres exigeant l'ouverture d'un dialogue entre les partenaires sociaux, l'adoption d'un système démocratique et la création d'une commission indépendante pour enquêter sur les violations des droits de l'homme, allant même jusqu'à demander par son secrétaire général, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed El-Radhi, un congrès national pour discuter des conditions critiques du pays et y trouver des solutions.
Entre-temps, le sergent-chef Cheikh Fall, basé à Paris - témoin des violations subies par les militaires et civils noirs dans la base militaire de Jreida - et Ladji Traoré de Nouakchott, avaient pu, via Radio France Internationale, dénoncer les violations qui se produisaient de Azlate à Nbeicka, puis à Inal et Nouadhibou, alors que le régime commençait à libérer certains militaires noirs.
Auparavant, le principal allié du régime avait quitté le Koweït le 27 février 1991 sous les frappes de "l'alliance internationale" qui se consacrait désormais à régler ses comptes avec les alliés de Saddam Hussein.
De plus, les vents du changement démocratique commençaient à souffler sur de nombreuses régions du monde, en particulier dans la sous région. La crise économique et sociale intérieure était à son comble en raison du blocus international imposé au régime et de la poursuite de la sécheresse pour la deuxième année consécutive.
Le président Ould Taya, dans une situation difficile, devait choisir entre rester fidèle à son ancien style en recourant à la répression et en consacrant son temps à lire des lettres et des demandes de soutien (comme la lettre des quatre mille signée par certaines forces politiques pour discréditer la démocratie, et la lettre des quatre cents signée par ce qu'on appelle les Noirs du régime), ou essayer de reprendre l'initiative pour contrecarrer le mouvement de protestation croissant afin de ne pas connaître le même sort que son ami malien Moussa Traoré.
L'agence mauritanienne de presse, soutenue par les experts en structures d'éducation des masses, le poussait vers la première voie, tandis que lui se dirigeait vers la démonstration qu'il était "le champion des retournements rapides et des virages dangereux". Non seulement il avait proclamé l'ouverture démocratique, mais il avait également libéré tous les détenus et, en prévision des célébrations du 1er Mai, avait annoncé le 18 avril 1991 l'ouverture des négociations entre les partenaires sociaux pour le 27 avril.
Ainsi, les choses allaient commencer à se détendre... Ould Taya négocierait ouvertement avec les syndicalistes durant le mois de mai, et secrètement avec les militaires libérés et les familles des disparus, tout en laissant un peu de temps aux politiciens pour harmoniser leurs positions et désigner leurs leaders.
Mais le mois de juin ne commencerait qu'une fois qu'il serait prêt à attaquer ses adversaires.
Il tiendrait les syndicats responsables des événements du pain qui avaient eu lieu le 2 juin 1991 à Nouadhibou, et arrêterait les leaders du Front démocratique le 3 juin - alors qu'ils se préparaient à annoncer la naissance de la FDUC - pour organiser un référendum sur la nouvelle constitution le 20 juin en leur absence, tout en lançant une campagne implacable contre les syndicalistes qui ne s'arrêterait qu'avec le renversement de leur secrétaire général Ould Mohamed Radhi le 26 juin, remplaçant celui-ci par son adjoint Mohamed Dina.
Ainsi, les élections présidentielles de janvier 1992 ne viendraient qu'après qu'Ould Taya ait réussi à reprendre l'initiative tant sur le plan interne qu'externe et soit devenu capable de façonner le processus à son avantage, malgré l'immense capacité mobilisatrice de son opposition, principalement représentée par le Parti de l'Union des forces démocratiques, et le ton défiant qui avait accompagné son lancement.
S.A. Ahmed El Hady




.jpeg)








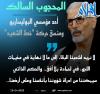




.jpeg)