
Les évolutions géopolitiques dans la région du Sahel africain s'accélèrent, posant des défis complexes aux pays de la région. Dans ce contexte, la Mauritanie apparaît comme un acteur relativement important grâce à sa position stratégique sur l'océan Atlantique et à sa stabilité politique par rapport à ses voisins. Pourtant, son rôle potentiel ne s'est pas encore clairement traduit en partenariats internationaux majeurs ou en alliances qui permettraient à la Mauritanie de tirer parti de la rivalité existante entre l'OTAN et ses concurrents, notamment la Russie.
Les transformations observées dans la région ces dernières années – comme le retrait de la France du Mali et de plusieurs pays voisins, ainsi que le renforcement du rôle russe – ont suscité l'intérêt occidental, surtout atlantique, pour la nécessité d'identifier des points d'ancrage alternatifs dans les pays du Sahel. Bien que la Mauritanie participe, dans une certaine mesure, à des mécanismes régionaux de lutte contre le terrorisme et de sécurisation des frontières, elle demeure hésitante à s'engager pleinement dans un axe international, de peur de nuire à sa souveraineté ou de provoquer la méfiance de ses voisins.
Cette analyse part de l'hypothèse que la Mauritanie, si elle exploite judicieusement sa situation géopolitique et ses ressources naturelles, pourrait devenir un élément clé dans toute future formule de sécurité régionale, à condition qu'une vision interne claire soit établit pour définir comment traiter avec l'OTAN et les autres puissances concurrentes.
Premièrement : les dimensions stratégiques de la situation géographique mauritanienne
La côte mauritanienne s'étend sur près de 700 kilomètres le long de l'Atlantique, offrant au pays une vue maritime qui permet de surveiller les routes commerciales et la navigation dans le voisinage régional, tout en créant un lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Cette extension géographique fait de la Mauritanie une porte d'entrée où convergent de nombreux intérêts internationaux, que ce soit en matière de sécurité des voies maritimes, de surveillance des mouvements des groupes armés ou de contrôle des flux migratoires traversant l'océan vers les côtes européennes.
Bien que la Mauritanie se soit engagée dans plusieurs accords avec l'Union européenne et certains pays occidentaux concernant le contrôle de ses frontières maritimes, ces accords ont eu un impact limité sur la relation avec l'OTAN, car aucune initiative ne reflète jusqu'à présent l'intégration de la Mauritanie dans un système de sécurité intégré.
Les observateurs estiment que la Mauritanie pourrait être dans une position plus forte si elle adoptait une politique de négociation plus approfondie, intégrant le contrôle de la bande côtière dans des accords de sécurité et économiques plus larges, permettant ainsi un investissement dans les ports et les technologies maritimes pour développer ses infrastructures internes et renforcer son rôle en tant que pôle régional.
Deuxièmement : la lutte contre le terrorisme entre succès sécuritaires et limites existantes
Malgré l'augmentation de l'activité des groupes terroristes dans la région du Sahel, la Mauritanie jouit toujours d'une relative stabilité ; elle a réussi depuis des années à contenir l'expansion des groupes armés, grâce à une stratégie qui mélangeait fermeté militaire et dialogue religieux, parvenant à éviter la répétition des scénarios sanguinaires vécus par des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Cependant, il ne faut pas exagérer en décrivant l'expérience mauritanienne comme un "modèle ancré", car la structure défensive du pays demeure limitée sur les plans technique et logistique, et l'absence d'un système de renseignement avancé fait que Nouakchott a constamment besoin de soutien extérieur. Bien que l'OTAN ait montré sa volonté de collaborer avec les pays de la région dans les domaines de la formation, de l'entraînement et du partage d'informations, l'intégration de la Mauritanie dans ce cadre est restée sporadique et fluctuante. Cela est en partie dû au souhait des autorités mauritaniennes de ne pas apparaître comme biaisées en faveur d'un partenaire international plutôt qu'un autre, ainsi qu'à leur prudence face à toute disposition pouvant susciter des sensitivités chez leurs voisins recevant un soutien russe (direct ou indirect).
Ici, la problématique réside dans l'absence d'une vision nationale à long terme qui dessine les limites de la relation avec l'OTAN, équilibrant la préservation de la souveraineté et l'exploitation des capacités de formation et technologiques que l'alliance pourrait offrir.
Troisièmement : Crise des migrants irréguliers entre pression intérieure et utilisation diplomatique
La crise des migrants irréguliers en Mauritanie atteint des niveaux sans précédent, le pays devenant un point de transit clé vers les îles Canaries espagnoles, avec une augmentation du nombre de migrants en provenance des pays d'Afrique subsaharienne et même d'Asie. Selon des rapports gouvernementaux et internationaux, la proportion d'étrangers résidant en Mauritanie est d'environ 10 % de la population, soit près d'un demi-million de personnes, avec des centaines de tentatives de passage mensuelles depuis les côtes mauritaniennes, notamment à Nouadhibou, en direction des côtes espagnoles.
Ces flux humains ont exercé une pression croissante sur les ressources limitées de l'État, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'eau, la santé et les infrastructures, alors que le pays souffre d'un taux de chômage élevé parmi sa population jeune, dépassant 30 % selon certaines estimations.
Cette situation a engendré des tensions sociales locales, face aux difficultés de contrôle des réseaux spécialisés dans le trafic des êtres humains, qui, selon les rapports médiatiques, peuvent percevoir jusqu'à 3000 euros par personne pour chaque migrants transporté.
Face à cette situation, les autorités mauritaniennes ont intensifié leur coopération avec les pays européens, notamment l'Espagne, à travers des accords axés sur la surveillance des frontières et le renforcement des capacités de sécurité et maritimes. Ainsi, Nouakchott a bénéficié d'un soutien technique et d'une aide logistique, mais ce soutien reste limité et ne répond pas aux défis, poussant le gouvernement à demander des financements supplémentaires et à transformer cette coopération en investissements structurels qui soutiennent la stabilité des zones touchées par le transit.
En revanche, la Mauritanie utilise ce dossier comme un atout diplomatique efficace dans ses relations avec l'Europe, cherchant à traduire sa position en tant que "rempart" contre les vagues migratoires, vers un partenariat stratégique plus large.
Avec l'intérêt croissant de l'OTAN pour les frontières sud de l'Europe, la crise migratoire pourrait renforcer la présence mauritanienne dans des arrangements de coopération en matière de sécurité plus larges, à condition que ces partenariats soient fondés sur le respect mutuel des intérêts et de la souveraineté, et évitent de faire peser sur la Mauritanie des charges disproportionnées par rapport à ses capacités.
Quatrièmement : Scénarios de la relation avec l'OTAN dans le contexte de l'expansion russe
La transformation continue dans la région du Sahel, particulièrement après le retrait de la France et l'augmentation de l'influence russe par le biais de groupes paramilitaires, pose de nouveaux enjeux pour la Mauritanie et l'OTAN. Quatre scénarios peuvent être envisagés, avec des impacts variés sur le pays :
• Scénario 1: Partenariat de sécurité avancé
Ce scénario nécessite l'engagement de la Mauritanie dans des partenariats militaires et de renseignement plus étroits avec l'OTAN, y compris une formation continue et un soutien logistique et technique en échange d'une intensification de la contribution aux opérations régionales de lutte contre le terrorisme. Cette option pourrait renforcer les capacités défensives mauritaniennes, mais elle pourrait également créer des défis géopolitiques concernant les relations de la Mauritanie avec ses voisins ayant des liens solides avec la Russie.
• Scénario deux : Équilibre prudent entre les puissances internationales
C'est le scénario dans lequel la Mauritanie continue d'exercer une politique d'ouverture limitée vis-à-vis de l'OTAN, tout en maintenant des canaux de communication avec la Russie, la Chine et certaines autres puissances, ce qui l'évite de glisser dans un des axes de concurrence internationale.
Ce scénario assure un certain degré de flexibilité diplomatique, mais prive le pays d'un partenariat profond avec une partie et peut lui faire perdre une réelle opportunité de renforcement de ses capacités.
• Scénario trois : Retrait mauritanien pour préserver l'indépendance
Il s’agit d’un recul par rapport à tout véritable intégration dans des arrangements de sécurité externes de peur d’influencer la décision nationale. Une telle démarche confère à la Mauritanie une indépendance apparente, mais elle peut accroître sa vulnérabilité face à l’augmentation des menaces dans l’environnement régional, sans compter la perte d'opportunités d'investissement et de formation qui pourraient contribuer à la modernisation du système militaire et sécuritaire.
• Scénario quatre : Option «ligne de défense» en faveur de l'Occident
La Mauritanie accepte ici de jouer un rôle de premier plan dans la containment de l'influence russe et dans la surveillance de ses mouvements dans le Sahel, s'appuyant sur un soutien financier et militaire occidental substantiel. Ce scénario aurait des gains économiques et sécuritaires immédiats, mais son prix pourrait se traduire par un ancrage d'une dépendance à long terme et par des tensions avec les pays ayant des relations étroites avec la Russie, ce qui aurait des répercussions sur la stabilité de la région dans son ensemble.
Conclusion
Il ressort de l'examen de la scène régionale que la Mauritanie se trouve à un carrefour entre les attraits et les pressions internationales, et que sa position stratégique attire l'attention de l'OTAN qui cherche à contenir l'influence russe croissante.
Cependant, les choix mauritaniens à cet égard restent soumis à plusieurs facteurs, notamment le désir de maintenir un degré raisonnable d'indépendance et l'hésitation à tisser des alliances approfondies qui pourraient avoir des répercussions négatives sur ses relations régionales.
Bien que l'expérience mauritanienne en matière de lutte contre le terrorisme offre un modèle relativement réussi dans le Sahel, le manque de planification stratégique globale, l'absence d'infrastructures de défense avancées et le peu d'investissements structurels empêchent ce pays de devenir une «puissance significative» capable de se donner une position négociatrice qui impose un plus grand respect international.
Et si la Mauritanie ne souhaite pas devenir un terrain de bataille pour des axes de conflit, elle est invitée à formuler des options claires qui ne laissent pas son sort aux aléas, tout en lui permettant d'affermir sa souveraineté et d'établir des partenariats qui servent ses intérêts, loin des pressions ou des diktats extérieurs.
Centre Awdagust d’études régionales




.jpeg)








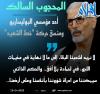




.jpeg)