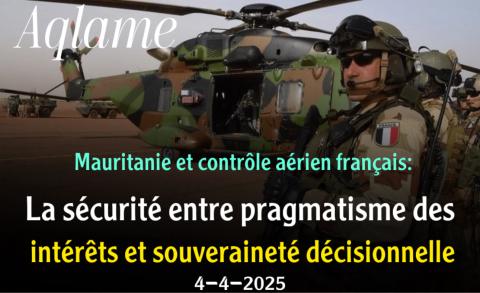
Dans le contexte des transformations géopolitiques que connaît la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la France envisage la possibilité de transférer une partie de ses capacités aériennes de surveillance du Sénégal vers la Mauritanie, particulièrement suite à la décision de Dakar de mettre fin à la présence militaire française sur son territoire. Ce scénario se présente comme une opportunité pour Nouakchott de renforcer ses capacités de sécurité, notamment en matière de surveillance des côtes et des frontières, à un moment où le pays fait face à des défis croissants tels que l'immigration irrégulière, le refuge, et l'augmentation du terrorisme et de la criminalité organisée dans son voisinage géographique.
Cette évaluation propose une lecture analytique de cette hypothèse, et discute de ses dimensions politiques, sécuritaires et régionales, en faisant le point sur l'importance de la surveillance aérienne française et de ses composantes, son contexte régional, et ses gains potentiels pour la Mauritanie, tout en insistant sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale et la spécificité de la décision mauritanienne indépendante.
La note conclut que la Mauritanie, qui a tranché depuis des décennies sa relation historique avec la France et a retrouvé sa souveraineté, est désormais capable d'entrer dans des partenariats de sécurité tactiques sans compromettre son indépendance stratégique, à condition que ces partenariats soient encadrés dans une vision nationale claire, et un équilibre précis dans ses relations extérieures.
Elle recommande la mise en place d'un cadre juridique strict pour toute coopération potentielle, et la condition de transfert ou d'exploitation conjointe des moyens aériens, tout en investissant une partie des revenus du gaz dans la construction d'une infrastructure nationale de surveillance et de renseignement.
Elle appelle également à gérer ce dossier avec transparence et communication institutionnelle et populaire, ce qui renforcerait la solidité de la décision souveraine et soutiendrait les efforts de la Mauritanie face aux défis sécuritaires régionaux croissants.
Préambule :
La région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest connaît des turbulences géopolitiques sans précédent, se manifestant par le recul de la présence française dans plusieurs pays qui étaient, jusqu'à récemment, des alliés traditionnels de Paris, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. En revanche, la France cherche à repositionner ses intérêts dans des pays plus enclins à la coopération sécuritaire selon de nouvelles approches qui mettent les intérêts nationaux en tête des priorités.
Dans ce cadre, la Mauritanie se distingue comme un candidat potentiel pour accueillir une partie des capacités françaises liées à la surveillance aérienne, suite à la décision du Sénégal de retirer ses bases françaises d'ici septembre 2025. Cette hypothèse soulève des questions fondamentales sur les dimensions de ce tournant stratégique, et ses répercussions potentielles sur la sécurité nationale mauritanienne, dans un environnement régional instable, et une crise sécuritaire croissante englobant le terrorisme, l'immigration irrégulière et la criminalité organisée.
La base française au Sénégal, connue sous le nom « éléments français au Sénégal » (EFS), se compose d'unités logistiques, de formation et de surveillance, parmi lesquelles l'avion de surveillance maritime Dassault Falcon 50 effectue des missions sensibles, y compris : la surveillance aérienne et maritime, la lutte contre la pêche illégale, le suivi des activités de contrebande et d'immigration, et l'exécution d'opérations de recherche et de sauvetage.
Alors que la France tente de maintenir une présence dans la région du Sahel, la Mauritanie se trouve également dans une situation de besoin croissant d'un soutien technique fiable pour renforcer sa capacité à sécuriser ses côtes.
1- Le contexte sécuritaire mauritanien et régional
La Mauritanie se trouve aux portes d'un environnement sécuritaire complexe, marqué par des flux humains croissants et des défis structurels entremêlés. La crise des réfugiés et des migrants dans le pays constitue l'une des principales de ces problématiques, où l'afflux d'un grand nombre de réfugiés maliens et de migrants irréguliers à travers de longues frontières impose des charges supplémentaires sur les ressources nationales, tout en contribuant à l'émergence de défis sécuritaires et sociaux de plus en plus complexes avec le temps.
S'ajoute à cela l'augmentation de l'activité des groupes terroristes armés dans des zones adjacentes telles que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce qui oblige la Mauritanie à continuer de renforcer ses capacités sécuritaires et de renseignement pour faire face à toute menace potentielle. Parallèlement à cette réalité, les zones frontalières connaissent une activité intense de gangs de contrebande et de criminalité organisée, ce qui nuit aux efforts de l'État pour établir un contrôle sur l'ensemble de son territoire.
Compte tenu de sa position géographique et de son long littoral, le pays se trouve devant l'urgence d'assurer la sécurité de ses côtes de manière stricte, notamment avec l'importance croissante des découvertes gazières dans ses eaux territoriales. Dans ce contexte, il est également évident que la concurrence internationale pour les ressources naturelles dans la région s'intensifie, avec la montée de grandes puissances comme la Chine, la Russie et la Turquie en Afrique de l'Ouest, ce qui a créé un terrain de compétition politique, économique et sécuritaire autour de la Mauritanie.
Dans ce sens, plusieurs facteurs sécuritaires et régionaux se croisent sur le terrain mauritanien, allant des flux de réfugiés et de migrants aux menaces terroristes et à la criminalité organisée, jusqu'à la nécessité pressante d'assurer la sécurité des côtes dans un contexte de forte concurrence internationale et régionale. L'ensemble de ces complexités place la Mauritanie au cœur d'un espace régional aux intérêts divergents et où les enjeux sécuritaires se multiplient, nécessitant des décideurs l'adoption d'approches pratiques et multidimensionnelles pour maintenir la stabilité nationale et renforcer la sécurité collective dans la région.
2- l'importance stratégique de la surveillance aérienne française pour la Mauritanie
Le transfert de la surveillance aérienne française vers le territoire mauritanien offre à Nouakchott plusieurs avantages stratégiques. Tout d'abord, cette démarche peut renforcer les capacités techniques de surveillance aérienne et maritime, grâce à l'utilisation d'avions de reconnaissance avancés tels que le Falcon 50, permettant ainsi de détecter avec une grande précision les activités illégales tant dans les eaux territoriales que dans les points de passage frontaliers.
En outre, ce transfert constitue un soutien direct aux efforts de sécurité maritime, notamment dans la protection des investissements stratégiques liés au gaz naturel, en plus d'aider à lutter contre l'immigration irrégulière et de faire face à la piraterie maritime. Parallèlement à l'aspect sécuritaire, une telle coopération militaire pourrait contribuer au développement des capacités de renseignement mauritaniennes ; les agences nationales bénéficieront des compétences techniques et professionnelles françaises dans le domaine de la surveillance aérienne et de l'analyse des données.
L'impact positif de cette initiative s'étend également à la formation et au transfert de technologie, avec la possibilité d'accompagner des projets et des programmes de formation et de perfectionnement qui amélioreront le professionnalisme et l'efficacité des institutions de sécurité et militaires mauritaniennes. De plus, on ne peut négliger les opportunités diplomatiques que pourrait offrir une telle coopération ; le renforcement des relations bilatérales avec la France en cette période sensible pourrait donner à la Mauritanie des marges de manœuvre supplémentaires dans les domaines économiques et de développement, tout en consolidant la position du pays sur le plan régional et international.
3- Considérations sur la souveraineté nationale et discours post-colonial
Contrairement à certains pays voisins qui continuent de souffrir de tensions liées aux périodes de colonialisme et de néocolonialisme, la Mauritanie a réussi à clarifier sa relation avec la France depuis les années 1970. Les luttes initiales des forces nationales ont poussé les autorités mauritaniennes à revoir les accords militaires avec Paris et à restaurer leur souveraineté sécuritaire, à nationaliser la société coloniale "Miferma" et à adopter la monnaie nationale (l’ouguiya) après une sortie courageuse et réussie du franc africain.
Ces étapes — pour lesquelles de nombreux peuples de la région luttent encore pour obtenir certaines d’entre elles — ont contribué à établir des bases solides pour une souveraineté nationale et ont permis que toute future partenariat avec la France ou d'autres pays soit fondé sur des mécanismes d'intérêts définis par les Mauritaniens eux-mêmes, loin du complexe de l'héritage historique. Cela s'est clairement reflété durant les périodes suivantes ces réalisations révolutionnaires sur les choix de la Mauritanie pour rechercher des partenariats stratégiques dans les domaines de la sécurité et de la défense, à partir d'une perspective pragmatique plaçant l'intérêt national au premier plan.
En conséquence, il est devenu possible de considérer la coopération avec la France dans le domaine de la surveillance aérienne, par exemple, comme une étape technique "dénuée de toute graisse coloniale" servant les objectifs de la sécurité nationale, loin des considérations historiques qui peuvent régir les relations de la France avec d'autres pays dans la région voire au-delà.
4- La dimension géopolitique et régionale
Sur le plan régional, la question des relations avec les pays voisins se présente comme un axe central dans tout nouveau positionnement militaire concernant la surveillance aérienne française. Bien que le Sénégal semble se diriger vers une réduction de la présence militaire française sur son sol, il pourrait ne pas accueillir favorablement le transfert de ces capacités vers un pays voisin de manière inconditionnelle ; ce qui nécessite une coordination préalable pour éviter que ce geste ne génère des tensions entre les deux pays ou dans l'environnement régional en général.
En ce qui concerne le Mali et les autres pays voisins, leurs positions sur cette décision peuvent varier en fonction de leur perception de l'impact de ce changement sur l'équilibre des forces régionales, en particulier face à la présence marquée des mouvements armés et des groupes terroristes.
Dans ce cadre, il ne faut pas non plus négliger la concurrence internationale croissante dans la région du Sahel, de nombreuses puissances mondiales cherchant à étendre leur influence ou à établir une présence militaire et économique, en raison des immenses richesses et ressources naturelles que détient la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Si la surveillance aérienne française est centrée en Mauritanie, d'autres acteurs concurrents tels que la Russie et même la Chine, qui surveillent également de près les évolutions de la région, pourraient soulever des interrogations. Néanmoins, la Mauritanie peut tirer parti de cette concurrence de manière positive en établissant des partenariats multilatéraux, tout en respectant ses propres intérêts sécuritaires et de développement.
Dans le cadre continental et régional, cette coopération pourrait représenter une opportunité pour soutenir les efforts des pays désireux de lutter contre le terrorisme, la piraterie et l'immigration irrégulière, en mobilisant les capacités françaises transférées en Mauritanie pour soutenir les missions de coordination des opérations de renseignement et militaires au niveau régional. Cependant, cette option dépend de la capacité de Nouakchott et de Paris à aligner ce rôle sur la vision des autres partenaires de la région, et à clarifier les limites de la coopération afin d’éviter que l'objectif militaire technique ne crée des sensibilités politiques.
5- Les principaux défis internes
La Mauritanie fait face à de nombreux défis internes qui pourraient affecter le succès de l'accueil de toute présence militaire française, qu'elle soit technique ou terrestre. Le plus remarquable de ces défis est lié à l'opinion publique intérieure, qui considère la présence étrangère dans le pays avec prudence, même si elle est cruciale pour des raisons de formation ou de surveillance. Bien que la Mauritanie ait surmonté le traumatisme de l'héritage colonial, la sensibilité excessive de certains acteurs politiques et sociaux pourrait créer un climat de doute concernant toute coopération militaire extérieure, ce qui oblige le gouvernement à adopter une politique de communication claire pour expliquer les dimensions de cette coopération et ses bénéfices.
Des craintes concernant la souveraineté nationale émergent également, car toute présence militaire étrangère nécessite des garanties juridiques et institutionnelles pour assurer aux autorités mauritaniennes un contrôle total sur leur espace aérien et leur domaine souverain, ainsi qu'une capacité à gérer les informations du renseignement de manière indépendante. Sans ces conditions, des inquiétudes sur la dépendance de la Mauritanie à des sources extérieures pourraient augmenter.
De plus, la logistique et la faiblesse des infrastructures pèseront sur la nature et le niveau de la coopération, car l'accueil d'avions de surveillance avancés comme le Falcon 50 nécessitera le développement des installations aériennes et des infrastructures associées, ainsi que la formation d'équipes locales capables de gérer cette technologie de manière efficace. En l'absence d'un investissement adéquat dans ce domaine, la coopération française risque de rester limitée et temporaire, et donc de ne pas se traduire par des gains stratégiques durables pour l'État mauritanien.
Conclusion :
Dans un environnement régional troublé caractérisé par une augmentation des menaces sécuritaires et une accélération des transformations géopolitiques, la nécessité oblige la Mauritanie à rechercher de nouveaux moyens pour renforcer sa sécurité nationale et protéger ses intérêts stratégiques. La coopération avec la France dans le domaine de la surveillance aérienne se présente comme une opportunité à exploiter dans une approche sécuritaire flexible, tenant compte des spécificités de la Mauritanie, tout en s'appuyant sur des expertises et des technologies avancées sans compromettre la souveraineté nationale.
L’ouverture à une telle coopération ne signifie pas dépendance ou servitude, mais reflète la capacité de la Mauritanie à adopter des politiques réalistes fondées sur le principe de l’intérêt national supérieur, tout en préservant son indépendance décisionnelle. La nécessité pour le pays d'une surveillance efficace de ses frontières et de ses côtes, face à l'augmentation de l'immigration irrégulière et à la montée des activités des groupes terroristes et des réseaux de contrebande, appelle à des solutions pratiques qui pourraient ne se réaliser que par des partenariats intelligents et ciblés.
Malgré la sensibilité politique et sociale que pourrait susciter la question de la présence militaire étrangère, l'État mauritanien est appelé à aborder ces préoccupations sous un angle stratégique, équilibrant les exigences de la sécurité nationale et les revendications d'autonomie complète. La protection des vies, des biens et des richesses nationales, ainsi que l'assurance de la stabilité du pays, sont des priorités que l'on ne saurait négliger, particulièrement dans une région où la survie et la pérennité sont soumises à la possession d'outils de dissuasion, de contrôle et de connaissance.
Ainsi, toute décision relative à l'accueil des capacités de surveillance aérienne françaises doit faire l'objet d'une étude approfondie, comprenant une évaluation objective des avantages et des risques, et s'appuyer sur des bases de transparence et de clarté, ainsi que sur une planification à long terme, afin d'assurer sa cohérence avec les grandes orientations de la sécurité nationale mauritanienne.
Recommandations :
À la lumière de ce qui précède, et afin d'assurer le maximum de bénéfice pour la Mauritanie de toute coopération potentielle avec la France dans le domaine de la surveillance aérienne, sans compromettre sa souveraineté ou ses intérêts nationaux, plusieurs recommandations stratégiques se dégagent :
- Il convient d'abord que le gouvernement mauritanien veille à encadrer la coopération envisagée dans le cadre d'un accord légal et technique rigoureux, incluant une définition précise du champ de cette coopération, de sa durée et de ses objectifs, tout en stipulant clairement les mécanismes de contrôle mauritaniens complets, ainsi que l'exclusivité de l'accès aux données de renseignement et aux résultats techniques qui découleront de cette coopération.
- Il serait également souhaitable de négocier avec la partie française la possibilité de transférer la propriété de l'avion Falcon50 (ou d'une partie des moyens techniques utilisés) à l'Armée de l'air mauritanienne, ou au moins d'opérer conjointement, ce qui renforcerait l'indépendance de la décision technique et garantirait la construction d'un cumul institutionnel local dans ce domaine vital.
- Dans ce même contexte, la Mauritanie devrait investir une partie des revenus de ses ressources naturelles, notamment le gaz, dans le développement de son infrastructure de renseignement et de surveillance aérienne et maritime, ce qui constitue un investissement intérieur clé pour réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers à l'avenir et bâtir un système de défense souverain intégré.
- Il est également crucial que la Mauritanie maintienne son équilibre dans ses relations extérieures et évite de s'engager dans des axes conflictuels au niveau régional et international. Le pragmatisme exige que Nouakchott ouvre des canaux de coopération avec tous les acteurs internationaux, à condition que cela soit en accord avec ses intérêts supérieurs et sa sécurité nationale.
- Il est tout aussi important d'impliquer l'opinion publique nationale et les élites politiques et civiles dans la discussion de cette coopération potentielle, à travers des campagnes de sensibilisation expliquant ses objectifs, ses avantages et ses conditions, garantissant ainsi un soutien national et renforçant sa légitimité interne tout en le protégeant des interprétations politiques ou médiatiques négatives.
Ces recommandations, si elles sont prises en compte, pourraient transformer le scénario de coopération française, s'il se concrétise, en véritable atout pour l'État mauritanien, lui permettant de protéger sa sécurité et d'exploiter sa position, sans compromettre ses principes souverains ou ses choix stratégiques indépendants.
Centre Audagust d'études régionales
03 avril 2025




.jpeg)








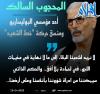




.jpeg)