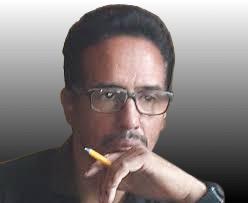
Toutes les encyclopédies et dictionnaires de référence (l'Encyclopédie des Concepts Islamiques, l'Encyclopédie de l'Esclavage et de l'Émancipation, le Black’s Law Dictionary) s'accordent à définir l'esclavage comme une condition dans laquelle l'être humain est privé de tous ses droits. Cependant, cette privation revêt des significations et des pratiques qui varient selon le contexte historique, économique et social.
L'exploitation excessive et la violence physique et verbale infligées aux esclaves furent parmi les traits distinctifs des sociétés médiévales, bien que certaines séquelles de ces époques persistent sporadiquement dans notre réalité contemporaine, notamment dans des sociétés dont les liens avec le passé demeurent organiques en raison de la rudimentarité de leurs moyens de production.
Ces séquelles ont propulsé la "question raciale" au-devant de la scène politique et des droits humains, tirant leur légitimité d'une mémoire collective encore meurtrie par les plaies béantes de son passé.
Or, la douleur de cette mémoire a masqué une autre forme d'esclavage, dont les victimes se comptent par millions à travers le monde, tant les parallèles sont nombreux : exploitation, privation de volonté, et surtout chantage – forme insidieuse d'asservissement, souvent exercée par des forces invisibles qui, dans de rares cas seulement, laissent transparaître leur violence.
C'est peut-être là la raison pour laquelle cette nouvelle forme d'esclavage n'a pas bénéficié de l'attention des instruments juridiques internationaux, contrairement à l'esclavage traditionnel, dont la criminalisation remonte au début du XIXᵉ siècle, précisément en 1807.
Il est étonnant de constater que les Nations Unies n'ont pas encore reconnu cette forme de servitude, malgré les profondes perturbations qu'elle a semées, même dans des sociétés réputées pour leur stabilité politique et leur attachement aux droits humains.
La protection des intérêts d'appareils de renseignement puissants empêche probablement l'émergence de ce concept sur la scène médiatique, de peur de provoquer un bouleversement de l’ordre social susceptible de faire tomber de leurs piédestaux ceux que l'on considère comme des "leaders".
La propagation rapide de cette forme d'esclavage soulève des problématiques psychologiques et juridiques majeures, notamment quant à l'identité sociale double d'individus désormais classés, virtuellement, parmi les nouveaux esclaves à la suite d'erreurs diverses.
Il n’est désormais plus besoin de contraintes physiques ni de traversées épuisantes sur les routes des anciennes caravanes d'esclaves : quelques technologies accessibles et d'un usage simplifié suffisent pour transformer, en toute facilité, des sociétés respectées en marchandises offertes sur les marchés de l'esclavage virtuel.
La large diffusion des smartphones, l'ignorance quant à l'importance de protéger ses données personnelles, et une curiosité naïve, surtout dans les communautés rurales, ont concouru à placer les Mauritaniens en tête de cette nouvelle catégorie de victimes.
Les données disponibles ne permettent pas d'estimer avec précision le nombre d'esclaves virtuels en Mauritanie, bien que plusieurs indicateurs laissent entrevoir une progression alarmante, alimentée par l'ignorance et l'inconscience du danger que représente la diffusion d'informations privées.
La pénétration des sphères personnelles commence par des liens d'apparence anodine, partagés via Facebook, WhatsAppet autres réseaux sociaux ; un simple clic permet aux pirates informatiques d'accéder aux téléphones des victimes, d'en contrôler les appels sensibles et même d'espionner leur intimité, à leur insu, croyant leurs appareils hors service.
La société n’a commencé à prendre conscience des risques technologiques qu’après la fuite d’enregistrements sonores et de vidéos compromettantes impliquant des figures politiques et médiatiques connues.
Certains estiment que les services de renseignement exploitent ce commerce honteux en diffusant des contenus choquants pour détourner l'attention de l’opinion publique de certaines affaires délicates – comme ce fut le cas pour certains chefs de l'opposition démocratique, un sénateur et plusieurs activistes des réseaux sociaux.
Le silence pesant de certaines figures publiques, les volte-face surprenantes d'anciens critiques du régime, et l'inexplicable laxisme des autorités face à certains dossiers sensibles, seraient – selon des observateurs avertis – autant de manifestations d'un autre type de provocation occulte, intimement liée à la dynamique de l'esclavage virtuel.
De nombreuses victimes, encore sous le choc, peinent à retrouver leur équilibre, et il n’est pas exclu qu’elles finissent par céder à la pression.
Toute tentative d’échapper à ce que l’on peut appeler "le servage du chantage" les replonge inexorablement dans le même cercle vicieux.
Ainsi, l’esclavage virtuel se régénère sans cesse, au sein d’une machinerie de chantage chronique, complexe et tentaculaire, érigée sur des murs invisibles de peur et d'un silence profondément énigmatique.
Dr . Meme Ould ABDALLAHI




.jpeg)








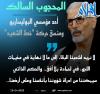




.jpeg)