
Le conflit du Sahara occidental est sans aucun doute l'un des conflits les plus complexes et les plus longs à résoudre dans le monde contemporain. Ses racines plongent à la fin de février 1976, lorsque l'Espagne a annoncé le retrait final de ses troupes de la région. Le 27 février de la même année, le Front Polisario a proclamé la création de la République arabe sahraouie démocratique, marquant ainsi le début d'une lutte acharnée pour l'autodétermination.
Après le départ des Espagnols, le Sahara occidental est devenu le théâtre d'une discordance entre trois acteurs aux intérêts divergents. D'une part, le Maroc et la Mauritanie ont tenté de se partager la région en vertu de l'accord de Madrid signé avec l'Espagne ; d'autre part, le Front Polisario s'est affirmé en tant que représentant légitime des Sahraouis, les populations autochtones qui revendiquent leurs terres. Ces derniers soutiennent que la décolonisation inachevée de la région leur confère des droits inaliénables sur le territoire, rejetant les prétentions marocaines et mauritaniennes.
Dans cette dynamique, l'Algérie se positionne comme un allié du Front Polisario, mettant en lumière la complexité des relations géopolitiques dans cette région du monde. Les frontières communes entre l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Sahara occidental, associées aux ressources minérales abondantes de la région, exacerbent les différentes revendications et les intérêts en jeu.
Le retrait espagnol, suivi par l'invasion marocaine et la déclaration d’indépendance du Front Polisario, a marqué le début d’une guerre dévastatrice entre le Maroc, la Mauritanie et le Front. Ce conflit a entraîné des pertes humaines tragiques et le déplacement de populations entières. En 1979, la guerre entre la Mauritanie et le Front Polisario a pris fin lorsque le nouveau gouverneur militaire mauritanien, Mostapha Ould Mohamed Saleck, a conclu que la poursuite du conflit représentait une menace existentielle pour son pays.
Néanmoins, le Maroc a continué d'occuper le Sahara occidental. La situation a été exacerbée dans les années 1980 par l'édification par le Maroc d'une série de murs défensifs, consolidant la division du territoire. En 1991, un cessez-le-feu a été instauré entre les parties, accompagné de la promesse d'un référendum sur l'autodétermination des Sahraouis ; un processus qui, hélas, n'a jamais vu le jour en raison de divers obstacles rencontrés, notamment les insistantes demandes du Front Polisario qui restent sans réponse.
À l'heure actuelle, le Front Polisario ne contrôle que 20 % des terres qu’il revendique, tandis que le Maroc a mis sur la table un plan d'autonomie depuis 2007, qui se concevrait sous sa souveraineté.
En somme, la crise du Sahara occidental demeure un conflit épineux et multidimensionnel et nécessite des engagements renouvelés et approfondis pour parvenir à une solution durable qui réponde aux aspirations des différentes parties prenantes.




.jpeg)




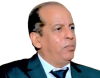







.jpeg)