
Dans le contexte des transformations géopolitiques que connaît la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays ont reconsidéré leurs partenariats sécuritaires traditionnels, se dégage l'importance de rappeler des moments décisifs de l'histoire des interventions extérieures, dont l'opération "Lamantin" menée par la France en Mauritanie en 1977. Dans son article publié dans la Revue Historique des Armées (n° 186, 1992), le général français Michel Forgues présente son témoignage analytique sur cette opération en tant que commandant sur le terrain.
L'intervention française est intervenu après une série d'attaques menées par le Front Polisario, ciblant des sites stratégiques dans le nord mauritanien, notamment la ligne de chemin de fer reliant Zouérate à Nouadhibou, ainsi que la ville de Zouérate elle-même, qui a été le théâtre de la mort de Français et de l'enlèvement d'autres. Ces attaques ont révélé la fragilité de la situation sécuritaire locale et ont poussé la Mauritanie, bien qu'ayant annulé ses accords de défense avec la France depuis 1972, à demander un soutien militaire français, dans une démarche reflétant la complexité de la situation stratégique dans la région.
Comme l'explique Forgues, l'objectif français n'était pas d'éliminer le Polisario, mais de faire pression pour qu'il cesse les grandes attaques et permettre à l'État mauritanien de retrouver son équilibre. L'opération a été menée de manière précise et prudente, par le biais de frappes aériennes ciblées de jets "Jaguar", soutenus par des avions de reconnaissance de type "Atlantique", depuis la base de Dakar, avec une coordination continue avec les autorités mauritaniennes.
Bien qu'elle ait réussi sur le terrain à réduire les attaques du Polisario et à améliorer la capacité de l'armée mauritanienne à répondre, le changement politique intervenu en Mauritanie après le coup d'État de juillet 1978, suivi d'un retrait progressif du conflit sahraoui, a modifié les perspectives de l'ensemble du paysage. Néanmoins, l'intervention française à cette époque a contribué à maintenir un minimum de stabilité dans une région menacée par des troubles plus vastes.
Une lecture de cet article aujourd'hui pourrait ouvrir la voie à une compréhension plus mûre du concept d'intervention extérieure et des multiples rôles que peuvent jouer les puissances internationales dans un environnement complexe comme le Sahel. Alors que les conditions d'aujourd'hui évoluent, les vieilles questions demeurent : comment équilibrer le soutien extérieur et la décision nationale ? Quelles sont les limites de l'aide lorsqu'elle est couplée à la réserve souveraine ? Quoi qu'il en soit, une relecture de l'opération "Lamantin" à une époque de redéfinition des arrangements sécuritaires constituera une expérience historique qui mérite réflexion, non seulement pour évaluer ce qui s'est passé, mais aussi pour anticiper ce qui pourrait être.
Opération Lamantin
Depuis la fin de l'année 1975 et tout au long de l'année 1976, le Front Polisario a mené une série d'attaques touchant plusieurs villes, bien qu'elles aient été de faible efficacité (Aïn Bentili, Bir Moudgreine, Nouadhibou, et Nouakchott le 8 juin 1976). Cependant, ces attaques sont devenues plus coordonnées et dangereuses à partir de 1977, se concentrant sur la voie ferrée reliant Zouérate à Nouadhibou, une ligne construite et entretenue par la France, considérée comme la principale artère de l'économie du pays.
Le Front Polisario s'est appuyé sur une tactique de guérilla, utilisant des colonnes rapides capables de surprendre leurs cibles et de revenir rapidement à leur point de départ. Dans ces colonnes, la voiture « Land Rover » a remplacé le chameau, et le fusil Kalachnikov – parfois des missiles sol-air – a pris la place de l'épée. Face à cette tactique, l'armée mauritanienne est restée impuissante. L'armée marocaine est intervenue pour protéger certaines villes menacées. Théoriquement, l'armée mauritanienne aurait pu se répartir en unités mobiles pour intercepter les convois du Polisario, mais en 1977, elle manquait de l'expérience et des moyens nécessaires pour mener à bien une telle mission.
Ainsi, la ville de Zouérate a été attaquée le 1er mai 1977, au cours de laquelle deux Français ont été tués, et six ressortissants français ont été enlevés. Ce secteur a également subi une deuxième attaque, puis une troisième ciblant le train le 25 octobre, au cours de laquelle deux Français et dix-huit Mauritaniens ont été capturés, mettant la France devant un problème de sécurité pour ses ressortissants et la Mauritanie face à la nécessité de préserver sa présence. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une intervention militaire française.
Des avions de reconnaissance français de type «Atlantique» ont commencé en septembre à effectuer des missions régulières pour surveiller la zone de la voie ferrée, depuis leur base à Dakar. Plusieurs alternatives ont été étudiées et des moyens d'intervention ont été mobilisés.
Ahmed El Hady
Bien que la Mauritanie ait dénoncé ses accords de défense avec la France en 1972, elle s'est tournée vers la France pour demander du soutien. La France ne pouvait pas rester les bras croisés face à cet appel, non seulement parce que la sécurité de ses ressortissants (techniciens militaires et civils) était menacée, mais aussi parce que le déclin de la Mauritanie dans la situation dans laquelle elle se trouvait alors risquait de provoquer une instabilité générale dans la région de l'Afrique de l'Ouest, que aucun des pays voisins (Maroc, Algérie, Mali, Sénégal) n'accepterait de considérer avec passivité. Sans aucun doute, c'est ici que réside la raison profonde de l'intervention française, compte tenu de l'importance de l'enjeu stratégique.
L'intervention française a été approuvée en principe le lendemain de l'attaque contre le train, le 28 octobre, un général de l'armée de l'air a été nommé pour diriger l'opération et les préparatifs ont commencé, elle a été appelée "Opération Lamantin", un nom étrange et inapproprié pour une opération de ce type.
Avec cette intervention militaire, la France ne visait pas à éliminer le Front Polisario, mais plutôt à le pousser à cesser ses attaques pour permettre à la Mauritanie de "reprendre son souffle" et de retrouver confiance en elle, afin de créer des conditions propices à une solution politique au problème. Les forces aériennes ont été chargées de la partie principale de la mission consistant à surveiller un - ou plusieurs - convois du Polisario et à agir avec beaucoup d'efficacité pour éloigner le front de toute envie de relancer une attaque.
La direction de l'opération n'avait pas le droit de prendre la décision d'ouvrir le feu sans demande du gouvernement mauritanien et approbation de cette demande par les autorités françaises, il était donc nécessaire d'établir un système permettant une intervention rapide dès qu'elle recevait l'autorisation d'ouvrir le feu, ce qui signifie que nous étions face à une opération très délicate réalisée avec des moyens limités mais avancés.
Après l'élaboration du plan d'opération avec le commandement général, le leader accompagné de ses aides (un de l'armée de terre et l'autre de la marine) se sont rendus à Dakar le 2 novembre, accompagnés d'une unité réduite composée d'un état-major réduit des différentes formations des forces armées, d'éléments de l'armée de l'air et de groupes de parachutistes de l'armée de terre. Tous devaient se cacher des regards de quelques journalistes qui cherchaient à Dakar et à Saint-Louis une force de parachutistes que la France était supposée utiliser pour son intervention militaire, n'ayant à l'époque aucune idée qu'elle pourrait intervenir d'une autre manière.
Et quand les journalistes ne purent pas constater l'effet de la force des parachutistes, ils interrompirent leur recherche à un moment où le commandant de l'opération (le général Michel Forge) était en train d'effectuer les communications nécessaires avec les autorités concernées et d'établir ses instances de commandement. Un centre de commandement avancé fut établi à Nouakchott, composé d'officiers spécialisés dans les communications et entouré de beaucoup de confidentialité, tandis qu'un autre centre pour les opérations et la logistique fut installé à "Awakam" (au Sénégal, à 450 km de Nouakchott). Bien que les instances de commandement soient devenues opérationnelles en quelques jours, il fallut attendre trois semaines pour que la préparation soit complète, c'est-à-dire pour que les ordres soient donnés aux avions participant à l'opération de se rendre à Dakar et que le général désigné reçoive l'autorisation de diriger les troupes sur le terrain.
À ce moment-là, les avions de reconnaissance stationnés à Dakar effectuèrent des missions de survol au-dessus de la Mauritanie sur ordre de l'état-major, et la situation empirait depuis le 27 octobre.
Le 4 novembre, "Hassi Birkendouz" situé près de la voie ferrée fut attaqué, et trois jours plus tard, le centre au nord-est d'Atar subit une nouvelle attaque réalisée par un convoi de 50 véhicules, et le 22 du même mois, un autre convoi composé également de 50 véhicules attaqua le train près du village d'Atouagel.
Cette dernière attaque fut l'occasion pour la France de donner son feu vert à l'opération "Lamantin", le général étant devenu depuis le 22 novembre "commandant des forces françaises en Mauritanie", se dirigea immédiatement vers le poste de commandement avancé à Nouakchott au moment où quatre avions Jaguar revenaient d'une mission d'entraînement au Togo pour être placés en alerte à Dakar, suivis d'autres quatre chasseurs le lendemain. Il semblait que le moment était venu de donner le signal de départ, cependant, il fallut attendre plusieurs jours avant d'obtenir le feu vert de Paris.
Le 2 décembre, le centre de Boulenouar a été attaqué par un convoi du Polisario, qu'il a occupé pendant trois heures avant de se retirer sous la surveillance d'un avion de reconnaissance français. Toutes les mesures ont été prises pour répondre à l'attaque, y compris l'arrivée des avions Jaguar qui ont survolé la cible directement pendant deux heures.
Cependant, la lumière verte n'est pas venue de France, ce qui a eu un effet négatif sur le moral des troupes françaises et des Mauritaniens.
Cependant, l'opération a bénéficié des leçons tirées de cette expérience, car les pilotes ont pu observer leur cible suffisamment longtemps de près et ont réussi à l'identifier intensément (système de circulation, contenu des véhicules, type d'armes...). Il était notable, durant cette surveillance, qu'il n'y avait aucune réaction du convoi face aux avions qui l'observaient de près tout au long de cette période, poursuivant son retrait comme s'ils n'existaient pas.
Le feu vert est venue le 12 décembre après une attaque contre un train le matin même, au sud d'Azoueirate, qui a été douloureuse pour les Mauritaniens en termes de nombre de victimes et d’incendie du train. Comme d'habitude, les attaquants sont restés sur les lieux de l'attaque pendant environ une heure avant de se retirer vers l'est avant midi.
Les avions de reconnaissance et de commandement surveillaient le convoi, et à ce moment-là, la France a donné son feu vert. Vers une heure de l'après-midi, le convoi était à portée de deux escadrilles d'avions Jaguar. Le convoi, composé de 50 véhicules, s'étendait sur une distance de 5 kilomètres et traversait une zone dégagée où il pouvait avancer rapidement.
Les pilotes ont senti qu'il y avait un convoi mauritanien dans la région poursuivant les attaquants, mais il était trop éloigné pour les rattraper, ils devaient donc prendre en charge la mission. Après l'intervention des avions d'attaque, le quart du convoi a pris feu et 13 prisonniers mauritaniens ont pu se libérer.
Les avions de reconnaissance ont continué à surveiller le reste du convoi toute la nuit, ayant réussi à parcourir 300 km dans une zone difficile avant de s'arrêter pour une pause à six heures du matin. Le feu vert pour attaquer le reste du convoi n'a été donné qu'environ à dix-sept heures, lorsque les avions Jaguar ont mis le feu à vingt de ses véhicules. Cela a été une leçon difficile, et c'était l'objectif que l'opération espérait atteindre.
Un troisième feu vert a été donné le 18 décembre après une attaque sur le centre de Tmeimichatt, et la moitié des cinquante voitures impliquées dans l'attaque ont été incendiées.
L'armée mauritanienne - qui est arrivée juste après les tirs - a pu récupérer de nombreux équipements, et des éraflures mineures ont été remarquées sur certains avions Jaguar.
Bien sûr, l'intervention française n'a pas résolu la crise, mais elle a marqué un tournant dans celle-ci car le Polisario a interrompu ses attaques intensives en provenance de Tindouf pendant un mois et s'est contenté de sabotages sur la voie ferrée à partir de bases à l'intérieur du territoire saharien, dont les résultats n'étaient pas graves et que l'armée mauritanienne - qui avait retrouvé sa confiance - pouvait gérer.
Bien que la garnison de Touajil n'ait pas pu résister à l'attaque du 25 janvier 1978, l'armée mauritanienne a réussi à repousser des attaques similaires à Chleh le 2 février et à Touajil le 28 du même mois.
Le 2 mai, une force mauritanienne a intercepté un convoi du Polisario se dirigeant vers la voie ferrée près de Zouérate, et le feu vert a été donné pour intervenir afin d'aider la force mauritanienne qui se trouvait dans une situation difficile.
Durant les journées du 2 et du 3 mai, les Jaguars réussirent à éliminer les deux tiers de la colonne attaquante, bien que son contact avec les forces mauritaniennes rendît la tâche difficile.
Après cette bataille, les affrontements militaires ont cédé la place aux événements politiques. Avec le 10 juillet, un coup d'État a eu lieu contre Mokhtar Ould Daddah, et la Mauritanie est entrée dans une phase de sortie du problème du Sahara occidental.
En octobre, la Mauritanie et le Polisario ont signé un accord de cessez-le-feu, et le 5 août 1979, la Mauritanie a rétabli ses relations avec l'Algérie et s'est entendue avec le Polisario pour affirmer que ni l'un ni l'autre n'avait de convoitise sur le territoire de l'autre.
En septembre de la même année, les troupes marocaines ont quitté le territoire mauritanien, tandis que la force de l'opération Lamantin est restée en place jusqu'en mai 1980. Bien que ce fût une petite force, elle aurait reçu le soutien nécessaire rapidement en cas de besoin.
Des troupes françaises ont été stationnées pendant un certain temps au nord de Nouadhibou avant que tout le monde ne parte au printemps 1980.
Et même si ce n'est pas notre tâche de dresser un bilan politique de cette opération, il convient de noter que la Mauritanie, bien qu'elle ait dû renoncer à ses ambitions antérieures dans le Sahara occidental, a maintenu sa souveraineté et son unité - qui avaient été menacées - tout en évitant la déstabilisation de la région de l'Afrique de l'Ouest.
L'opération Lamantin - par son approche et ses résultats - a contribué de manière significative à créer les conditions propices à cette situation.




.jpeg)








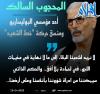




.jpeg)