
Lors d'une séance d'audition parlementaire tenue le 14 avril 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déclaré que son pays "partage de nombreux intérêts avec la Mauritanie, du fleuve à la mer, de la pêche au gaz, ainsi que des questions géopolitiques et sécuritaires". Il a ajouté : "Lorsque deux nations partagent un tel volume d'intérêts, elles doivent interagir au mieux, et c'est ce que nous espérons de nos frères mauritaniens", affirmant à la fin de son propos une "confiance totale en nos frères en Mauritanie".
Ces déclarations interviennent dans un contexte de profonds changements dans l'environnement géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et de la région sahélienne, ce qui lui confère une dimension exceptionnelle et une rare opportunité pour la Mauritanie de redéfinir sa position régionale, étant donné que la région traverse une phase de transition complexe, marquée par un changement des rapports de force traditionnels, le recul des rôles habituels de certains partenaires internationaux, et l'émergence de nouveaux acteurs cherchant à combler le vide sécuritaire, économique et politique. Dans ce contexte, les déclarations sénégalaises prennent un caractère qui dépasse la simple politesse diplomatique, se transformant en un appel implicite à formuler un partenariat avancé.
Pour la Mauritanie, saisir ce moment historique ne représente pas seulement une opportunité de renforcer la coopération bilatérale, mais aussi une plateforme pour construire une influence régionale fondée sur des éléments de stabilité, de légitimité politique et d'intégration économique ; car le repositionnement de Nouakchott dans le contexte actuel, hautement complexe, nécessite de trouver un allié ou des alliés fiables, et le Sénégal est un candidat idéal à cette étape sensible.
La Mauritanie et le Sénégal sont aujourd'hui parmi les rares pays à avoir réussi à maintenir leur stabilité démocratique dans un environnement régional dominé par les coups d'État et les régimes de transition, surtout après l'effondrement effectif du groupe des cinq pays du Sahel G5 et la formation d'une confédération militaire fermée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette dynamique accélérée pourrait offrir aux deux pays une occasion précieuse de se démarquer aux yeux de leurs partenaires internationaux, non seulement comme modèles de stabilité, mais aussi comme plateformes prometteuses pour lancer des initiatives régionales crédibles.
Parallèlement, la coopération économique entre les deux pays offre des opportunités sans précédent d'intégration, notamment à la lumière des découvertes de gaz commun dans le champ "GTA", qui place les deux États sur la carte des pays producteurs d'énergie en Afrique subsaharienne et ouvre la voie à un essor énergétique commun qui pourrait redéfinir les contours de la sécurité énergétique dans la région. Cette coopération prend une importance supplémentaire compte tenu des transformations que connaît le monde sur le marché énergétique mondial, où le gaz naturel occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies de transition énergétique.
La coopération entre les deux pays va au-delà du secteur de l'énergie, englobant d'autres secteurs vitaux tels que la pêche et la gestion des ressources en eau communes, où les accords régissant la pêche et la gestion du fleuve Sénégal sont des exemples vivants de la capacité des deux pays à gérer des ressources stratégiques de manière collaborative. Ces cadres offrent une mécanisme institutionnel sur lequel s'appuyer pour élargir la coopération vers des domaines plus variés, y compris le transport terrestre et fluvial, l'agriculture durable, la transformation numérique et le développement d'infrastructures intelligentes.
Cette vision expansive de l'intégration bilatérale ne se limite pas à renforcer la relation mauritanienne-sénégalaise, mais permet également de concevoir un modèle d'intégration régionale miniature pouvant être élargi et reproduit dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest.
La relation bilatérale tire également sa force d'une dimension communautaire profonde, où le mélange démographique, linguistique et religieux constitue un facteur d'unité rare dans le contexte africain. Elle représente l'un des éléments les plus marquants de la stabilité structurelle des relations entre les deux pays ; l'interconnexion profonde entre les groupes de population des deux rives du fleuve Sénégal, qui se manifeste dans les relations familiales et les liens culturels et économiques transfrontaliers, confère à toute coopération politique ou économique une dimension populaire et sociale difficile à déconstruire ou à influencer négativement.
Cette fusion renforce également la résilience de la relation contre les fluctuations politiques ou les pressions extérieures, et établit une base humaine soutenant tout projet d'intégration futur, notamment si la société civile est intégrée aux mécanismes de planification et d'exécution commune.
En revanche, les transformations géopolitiques actuelles, à commencer par le desserrement de l'emprise française et le retrait de l'engagement occidental dans le Sahel, engendrent un vide régional notable que les cadres traditionnels ne parviennent plus à contenir ou à combler efficacement.
Le retrait de certains partenaires internationaux a perturbé les équilibres sécuritaires et économiques existants depuis des décennies, permettant à des acteurs non traditionnels de tenter de remplir ce vide, parfois selon une logique unilatérale ou sécuritaire.
Dans ce contexte de recul institutionnel, le rapprochement sénégalais-mauritanien se présente comme une opportunité qualitative pour se repositionner de manière pragmatique et équilibrée, permettant la construction d'une alliance rationnelle et progressive, capable de combler ce vide par une approche de développement intégrale et souveraine, plutôt que par une dépendance.
Cette alliance ne compense pas seulement l'absence institutionnelle, mais peut également établir un nouvel équilibre régional plus en harmonie avec les exigences de stabilité et de développement dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Dans ce cadre, les déclarations du Premier ministre Sonko ouvrent une fenêtre stratégique rare pour la Mauritanie, qu'il ne faut en aucun cas négliger. Elles illustrent la volonté politique d'un partenaire régional fiable et stable, offrant à Nouakchott l'opportunité de passer d'une position d'État prudent et observateur à celle d'un acteur participant à la formulation des équilibres régionaux.
En agissant de manière intelligente et réfléchie, et en ayant une lecture précise des variables, la Mauritanie peut avancer par étapes solides vers la construction d'une alliance régionale multidimensionnelle avec le Sénégal, fondée sur un dialogue stratégique continu, l'expansion des accords et la coordination des positions sur les plateformes continentales et internationales.
Cette transformation nécessite le renforcement des cadres institutionnels existants, à travers le lancement d'un mécanisme de consultation bilatérale permanent incluant les dossiers économiques, sécuritaires, énergétiques et environnementaux, ainsi que le renforcement de la présence de la société civile et du secteur privé dans l'élaboration de projets communs.
La Mauritanie doit également tirer parti du moment diplomatique pour former un espace de coopération trilatéral ou quadrilatéral, regroupant des pays aux visions et ambitions similaires, ce qui garantirait la diversification des partenaires et renforcerait la marge géopolitique du pays.
Plus important encore est le maintien de l'équilibre et de la transparence dans la gestion des dossiers sensibles, en tête desquels figure le dossier de la production de gaz commun, qui constitue la pierre angulaire de tout partenariat économique futur. Une gestion judicieuse de cette ressource stratégique garantira les intérêts des deux pays, limitera les probabilités de tensions et conférera une plus grande crédibilité à l'alliance naissante devant les partenaires régionaux et internationaux.
Ainsi, la relation mauritanienne-sénégalaise se démarque dans une région où les alliances s'effritent, la confiance s'érode et la fragilité des cadres régionaux traditionnels augmente, apparaissant comme une perspective prometteuse pour remodeler l'espace régional sur des bases nouvelles, plus réalistes et durables.
C'est un moment exceptionnel dans le temps politique de la région, qui exige de Nouakchott de dépasser la logique de l'attente et de prendre l'initiative d'activer ses outils diplomatiques et stratégiques pour établir un partenariat avancé avec le Sénégal, non seulement en tant qu'allié naturel, mais aussi en tant que partenaire stratégique dans la formulation d'un nouvel équilibre régional. L'initiative à ce stade n'est pas une option politique, mais une nécessité existentielle pour garantir la place de la Mauritanie dans les équations de demain, dans un environnement tumultueux et compétitif qui ne pardonne pas les indécis.
Centre Awdagust d’études régionales




.jpeg)








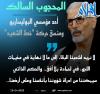




.jpeg)